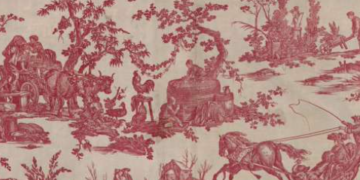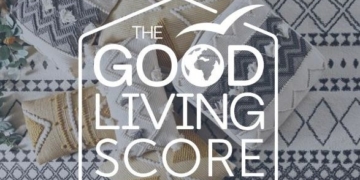En France, le tri du verre pourrait connaître une évolution décisive. Depuis des années, les citoyens jonglent avec des consignes complexes, contraints de distinguer bouteilles et bocaux recyclables des verres à eau, carafes ou flûtes à champagne considérés comme non recyclables. Mais cette frontière, méconnue et mal comprise, est en passe d’être remise en cause. Car la demande citoyenne est claire, les industriels sont prêts et la faisabilité technique est démontrée : le verre des arts de la table peut rejoindre le verre d’emballage dans le même bac.
L’étude OpinionWay réalisée en juillet 2025 auprès d’un échantillon exceptionnellement large de 3 020 personnes, représentatif de la population française et conforme à la norme ISO 20252, révèle une situation sans ambiguïté. 9 Français sur 10 se disent favorables à l’idée de déposer le verre de table usagé avec le verre d’emballage, dont près des deux tiers « tout à fait favorables ». Et 95 % jugent nécessaire de simplifier le geste de tri, considérant que, dans les faits, « personne ne fait la différence » entre un verre recyclable et un verre qui ne l’est pas.
Cette adhésion repose sur une réalité déjà observable : 7 Français sur 10 jettent aujourd’hui leurs verres usagés avec le verre d’emballage. Une confusion accentuée par le fait que près de la moitié de la population croit, à tort, que tous les types de verre sont recyclables. 4 Français sur 10 estiment que seuls certains le sont, tandis que 15 % reconnaissent ne pas savoir. En Île-de-France, cette incertitude est encore plus forte, avec près d’un répondant sur 5 incapable de trancher.
Les comportements reflètent cette méconnaissance. Plus de 6 personnes sur 10 conservent chez elles de vieux objets en verre, parfois brisés ou dépareillés. Lorsqu’elles souhaitent s’en séparer, elles se tournent majoritairement vers les colonnes à verre ou les bacs de recyclage, quitte à s’y tromper. Les 25-34 ans apparaissent plus enclins que la moyenne à se débarrasser de leurs verres usagés, tandis que les plus de 35 ans se montrent plus favorables à une simplification des consignes (96 %, contre 89 % chez les moins de 35 ans). Autre signe d’incertitude : 4 Français sur 10 avouent ne pas savoir distinguer un verre classique du cristal.
Une faisabilité technique confirmée
Du côté des industriels, l’argumentaire est solide. Après trois années de travaux techniques et d’échanges avec l’ensemble des parties prenantes – pouvoirs publics, collectivités, associations, verriers –, la conclusion est claire : 99 % du verre des arts de la table est recyclable avec le verre d’emballage. Le gisement ne représenterait que 2 à 4 % du volume actuel et serait facilement absorbé par les infrastructures existantes. Une telle évolution permettrait de recycler jusqu’à 100 000 tonnes supplémentaires chaque année. Elle offrirait aussi aux verriers français une source locale et sécurisée de calcin, renforçant une boucle de production fermée et contribuant à la décarbonation de leur industrie.
La cohérence avec l’évolution des consignes de tri est là, reste la décision politique
Alors que les communes ont déjà élargi les consignes de tri pour les emballages plastiques et métalliques, maintenir une séparation entre différents types de verre apparaît contre-intuitif. Les acteurs de la filière – ARC France, La Rochère, Duralex, appuyés par la Confédération des Arts de la Table et Francéclat – plaident donc pour une réforme de « bon sens ». Comme le souligne un représentant de Francéclat, « rendre plus simple, donc plus lisible et efficace le geste de tri, c’est donner plus de débouchés à des milliers de tonnes de verre chaque année ». Les industriels appellent désormais à la constitution d’une équipe projet collective avec l’État, les collectivités et les associations, afin de définir le cadre technique et financier de cette réforme. Au croisement des attentes citoyennes, des impératifs environnementaux et des capacités industrielles, le recyclage du verre des arts de la table s’affirme comme un projet d’utilité publique, prêt à être concrétisé.